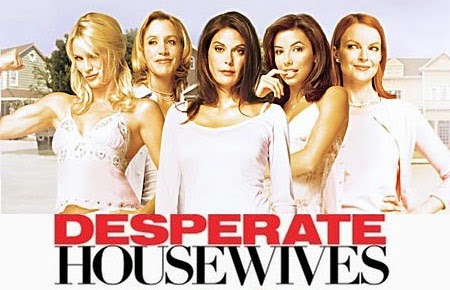Il y a deux semaines s’est achevée la troisième et dernière
saison d’Hannibal, la série de Bryan
Fuller centré autour du personnage du Dr Lecter, le psychopathe cannibale du Silence des Agneaux. Si les deux
premières saisons étaient vraiment de haute qualité, la troisième me laisse une
impression plus mitigée. Sa première partie du moins, pendant laquelle la série
devient presque une caricature d’elle-même, avant de changer du tout au tout
pour revenir à ce qu’elle était dans ses saisons originelles et raconter des
évènements directement adaptés de Dragon
Rouge (le prequel du Silence des
Agneaux).
Sanglante, violente, lente, torturée, Hannibal n’est pas une série à mettre entre toutes les mains. Difficile
de penser qu’elle a pu exister pendant trois ans sur un network américain comme
NBC. Certes les audiences n’étaient pas bien brillantes, mais il faut tout de
même reconnaitre à cette série un certain nombre de qualités qui lui a permis
de revenir d’une année sur l’autre. J’en compte au moins cinq qui vont
probablement me manquer.
Hugh Dancy (interprète de Will Graham) : contrairement à ce que le titre de la série veut bien nous
laisser penser, Hannibal n’est pas le personnage principal de la série. Ou
plutôt, il serait plus correct de dire qu’il partage l’affiche à parts égales avec
celui de Will Graham, profileur de génie recruté par le FBI pour enquêter sur
des affaires toutes plus sordides les unes que les autres. Car Will a un don, une sorte de sixième sens
qui lui permet de se mettre dans la peau des serial killers qu’il traque pour
comprendre leur logique et prédire leurs agissements. Mais ce don affaiblit son
esprit : plus il s’en sert, plus il sombre dans la folie, ayant chaque
fois plus de mal à sortir indemne de cet état de transe.
Et c’est ce côté fragile, tourmenté, angoissé du personnage
que Hugh Dancy interprète à merveille. Le comédien, absolument charmant et au
moins aussi charismatique que son partenaire, transcende chaque scène dans
laquelle il apparait avec un jeu pourtant sobre mais terriblement efficace. Sa
voix tremblante, sa respiration saccadée, ses tremblements incontrôlés
concourent à susciter une profonde empathie pour ce personnage ô combien
perturbé, voire même aliéné.
M. Dancy, j’ai hâte de vous retrouver ailleurs (dans the Way, par exemple aux côtés du non
moins génial Aaron Paul).
Mads Mikkelsen (interprète d’Hannibal Lecter) : l’exercice de succéder à l’une des meilleures interprétations
(la meilleure ?) de psychopathe par l’un des plus grands comédiens du
monde n’était pas chose aisée. Et pourtant, Mads Mikkelsen relève le défi haut
la main. C’est peu surprenant quand on connait le charisme de ce comédien
danois mais il n’en reste pas moins que c’est une belle prouesse.
Froid mais raffiné, élégant et terriblement magnétique, cet
Hannibal-là inspirerait presque de la sympathie si on ne connaissait pas les
travers culinaires du personnage. Et d’ailleurs, le début de la série ne révèle
rien des méfaits du Dr Lecter, afin que le public puisse accepter ce personnage
au patronyme si emblématique. Hannibal n’est là que pour aider Will à vaincre
ses démons. La diction de Mikkelsen, envoutante à souhait et son regard aussi
séduisant qu’inquiétant hypnotise le spectateur, qui une fois séduit, se
retrouve d’un coup confronté à la froide violence de ce personnage impassible.
L’esthétique macabre : je l’ai dit plus haut, mais Hannibal n’est pas une série à mettre entre toutes les mains en
raison de sa violence. Autant le dire tout de go : c’est gore, ça
sanguinole et ça coupe l’appétit. Les scènes de crimes des premières saisons
sont toutes plus recherchées les unes que les autres. Il faut reconnaitre que
les scénaristes se sont bien creuser la cervelle (Hannibal aurait adoré) pour
trouver des mises à mort toujours plus sophistiquées et toujours plus
dérangeantes. Je pense à la culture des champignons ou aux anges écorchés
vifs de la saison 1, au cheval ou au
tableau humain de la saison 2 ou au sort de ce pauvre Dr. Chilton dans la
saison 3 (ceux qui savent savent ; les autres, je préfère ne pas vous
dégouter en allant plus loin dans les descriptions). J’en passe et des plus rouges.
Mais bizarrement, cette violence est superbement mise en image.
L’attention accordée à la réalisation, à la photographie et aux décors lors des
scènes gores tend à magnifier tout ce qui devrait, de prime abord, nous
rebuter. On découvre alors de véritables œuvres d’art morbides et lugubres, qui
ne sont pas sans rappeler de nombreuses peintures célèbres, d’ailleurs maintes
fois citées dans la série. Et c’est là encore une prouesse d’Hannibal : réussir à repousser les
limites du macabre sur un des networks majeurs sans pour autant se vautrer dans
un voyeurisme malsain (coucou the Walking Dead).
L’esthétique culinaire : qui dit Hannibal Lecter dit viande rouge saignante. Et tous
ses dérivés. On le sait, le psychopathe aime cuisiner et il le fait bien. Il
adore mettre les petits plats dans les grands. Pour lui, la bouffe, c’est une
religion.
Les scènes de cuisine de la série sont tout aussi sophistiquées
et recherchées que les scènes de meurtres. Parfaitement réalisées, impeccablement
mises en lumière, et toujours accompagnées d’une musique classique relaxante, elles
donneraient presque faim si on veut bien oublier d’où provient la viande. Ces
mets très raffinés sont de véritables sculptures, aussi travaillés que ne le
sont les cadavres découverts par Graham et son équipe. En réalité, l’élégance est un pilier de la série, à tout
niveau : les décors, les costumes, la musique… Mais ce sont bien les
recettes d’Hannibal qui reflète le mieux sa grâce et sa beauté.
 Gillian Anderson (interprète de Bedelia Du Maurier) : Bon alors là, j’avoue que c’est le fan de l’actrice qui
parle. Je n’y peux rien et je ne me l’explique pas, mais quand Gillian Anderson
est à l’écran, je suis happé, captivé, hypnotisé. Elle n’a pourtant pas un rôle
des plus intéressants – elle joue la psy d’Hannibal – et elle est même plutôt
mal servie par la saison 3 (hormis quelques scènes avec notamment Zachary
Quinto qu’on aime aussi très fort) mais elle n’a rien perdu de son charisme
légendaire. Plus proche de Stella Gibson (The
Fall) que de Dana Scully (X-Files),
Bedelia marque une nouvelle étape dans la carrière décidément très réussie de
Gillian.
Gillian Anderson (interprète de Bedelia Du Maurier) : Bon alors là, j’avoue que c’est le fan de l’actrice qui
parle. Je n’y peux rien et je ne me l’explique pas, mais quand Gillian Anderson
est à l’écran, je suis happé, captivé, hypnotisé. Elle n’a pourtant pas un rôle
des plus intéressants – elle joue la psy d’Hannibal – et elle est même plutôt
mal servie par la saison 3 (hormis quelques scènes avec notamment Zachary
Quinto qu’on aime aussi très fort) mais elle n’a rien perdu de son charisme
légendaire. Plus proche de Stella Gibson (The
Fall) que de Dana Scully (X-Files),
Bedelia marque une nouvelle étape dans la carrière décidément très réussie de
Gillian.
La série a été souvent critiquée pour sa noirceur, pour sa
lenteur ou pour ses digressions à ses débuts. Mais c’est une franche réussite :
captivante, angoissante, parfois sordide, elle nous a plongé dans un univers
malsain mais terriblement élégant. Comme si les bonnes manières servaient à
compenser l’amoralité. Hannibal ne se regarde pas à la légère mais elle compte
sans aucun doute parmi les meilleures séries proposées par les networks ces
dernières années. A déguster avec finesse pour ceux qui seraient passés à côté.








.jpg)